

Chez Black Ego, le passé inspire le futur . Nous explorons et partageons l’histoire fascinante de l’Afrique, de ses civilisations anciennes à ses héros modernes. Notre mission est de reconnecter les générations actuelles à l’héritage culturel du continent, à travers des récits captivants, des découvertes archéologiques et des initiatives éducatives.
Localisation
Dans le temple du savoir !Jeune Afrique interviewe Blaise Compaoré

Metisse Noire
Categories: Faits historiques, Histoire de l'Afrique
Le 04 Novembre 1987 ,Jeune Afrique interviewe Blaise Compaoré suite à l’assassinat de Thomas Sankara

Jeune Afrique : Vous avez désormais sur la conscience, et sans doute pour toute votre vie, la mort de votre meilleur ami, Thomas Sankara…
Blaise Compaoré : J’aurais pu l’avoir sur la conscience si j’avais ordonné de l’abattre. Or ce n’est pas le cas. C’est pour avoir voulu nous liquider, Jean-Baptiste Lingani, Henri Zongo et moi, qu’il s’est fait abattre par des soldats qui me sont fidèles.
Jeune Afrique : Maintenant qu’il est mort, vous ne risquez pas d’être contredit.
Blaise Compaoré : Il est mort, et c’est bien dommage en effet. Nous les Africains, nous sommes très sensibles à la mort. C’est d’ailleurs pourquoi même ceux qui pouvaient le détester affichent une certaine consternation. Je suis moi-même très triste, parce que la mort de Thomas n’était pas la condition sine qua non pour régler les sérieux problèmes qui se posaient à notre révolution.
Jeune Afrique : Alors qui l’a tué, et pourquoi ?
Blaise Compaoré : Les soldats qui partaient pour l’arrêter ont été obligés de faire usage de leurs armes lorsque Thomas Sankara et sa garde personnelle ont ouvert le feu sur eux.
Jeune Afrique : Qui avait ordonné de l’arrêter ?
Blaise Compaoré : Les soldats ont pris eux-mêmes cette initiative, quand ils ont été contactés pour participer à notre arrestation et à notre élimination.
Jeune Afrique : Dans votre armée, n’importe quel militaire peut ainsi décider d’arrêter le chef de l’Etat, sans y avoir été invité par ses supérieurs ?
Blaise Compaoré : Ils m’ont expliqué, après le drame, qu’ils savaient que je n’aurais pas accepté de faire arrêter Thomas s’ils venaient m’annoncer que celui-ci préparait notre assassinat, à 20 h ce jeudi 15 octobre.
Jeune Afrique : Pourquoi ?
Blaise Compaoré : Connaissant mon amitié pour lui, ils savent que je n’aurais pas pris une telle décision sans preuve des projets du président.
Jeune Afrique : Quelles preuves avez-vous aujourd’hui pour excuser la dramatique initiative de vos soldats ?
Blaise Compaoré : Lorsque je suis arrivé au Conseil de l’Entente après la fusillade et que j’ai vu le corps de Thomas à terre, j’ai failli avoir une réaction très violente contre ses auteurs. Cela aurait sans doute été un carnage monstre dont je ne serais certainement pas sorti vivant. Mais quand les soldats m’ont fourni les détails de l’affaire, j’ai été découragé, dégoûté. Je suis resté prostré pendant au moins vingt-quatre heures. De plus, j’étais malade et dans mon lit quand les coups de feu m’ont réveillé.
Jeune Afrique : Et vous avez ordonné d’aller l’enterrer sommairement dans le cimetière des pauvres, à dix kilomètres de Ouagadougou ?
Blaise Compaoré : Non ! J’avoue que je ne me suis pas occupé de cela. Dans mon esprit, les corps des victimes devaient être transportés à la morgue et être restitués ensuite à leur famille. C’est seulement le lendemain que j’ai appris qu’ils avaient été enterrés à Dagnien. Thomas Sankara ne peut pas être enterré ailleurs qu’au cimentière des militaires. Le Front populaire va d’ailleurs prendre les dispositions qu’il faut pour cela.
Jeune Afrique : Pourquoi n’a-t-on pas demandé d’explications à ceux qui l’ont tué ?
Blaise Compaoré : Vous savez, nous sommes des militaires. Thomas a personnellement vidé son chargeur. Le seul gendarme qui ait été abattu dans cette fusillade l’a été par le président. On ne peut pas reprocher à des militaires de riposter quand on tire sur eux. D’autre part et contrairement à vous, les journalistes étrangers, notre préoccupation première a été de proposer tout de suite quelque chose de concret à notre peuple, pour poursuivre la révolution et ne pas risquer de tomber dans les travers qui ont conduit au drame que nous déplorons tous.
Jeune Afrique : Que proposez-vous, à présent, à votre peuple ?
Compaoré : Quand j’ai demandé à mes hommes pourquoi ils avaient arrêté Sankara sans me le dire, ils ont répondu que s’ils l’avaient fait, j’aurai refusé. Et c’est vrai. Je savais que mon camp politique était fort. Thomas ne contrôlaient plus l’Etat. Je n’avais plus besoin de faire un coup d’Etat. Mais mes hommes ont pris peur quand ils ont appris l’après-midi que nous devions être arrêté à 20h.
Compaoré : J’ai assumé, sans chercher plus loin, les conséquences de leur acte.
Recent Blog
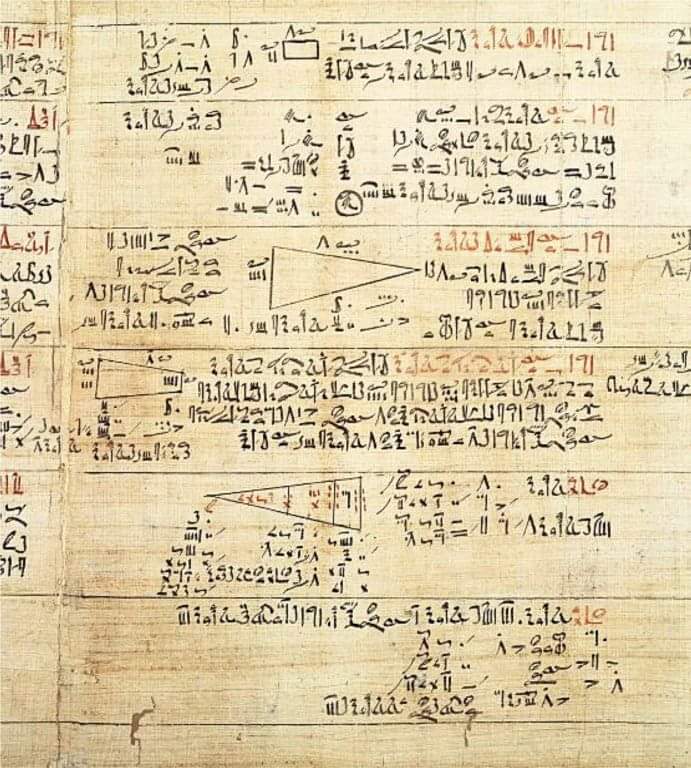
mars 1, 2025
Metisse Noire
Copyright 2024 Archaeology theme. All Rights Reserved.


